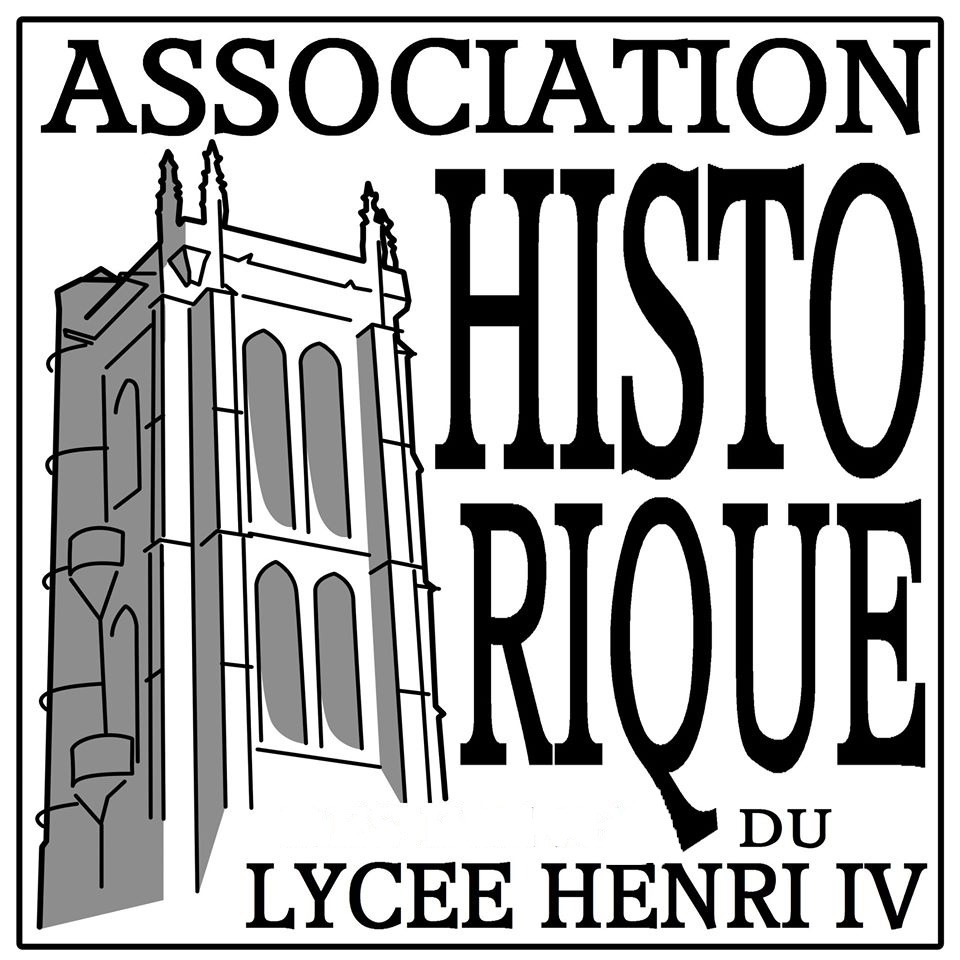C'était au mois de janvier 1986
Huit élèves de la classe préparatoire à l’École des chartes du lycée Henri-IV tenaient l’assemblée constitutive de « l’Association historique des élèves du lycée Henri-IV ».
L’association fut déclarée sous ce nom le 26 janvier 1986 à la préfecture par l’un de ces élèves : Olivier Andru. Celui-là avait fait et lu le discours inaugurant le chantier de Bibracte, en la présence du Président de la République. De là, l’idée de fonder une association qui commémora cet évènement, en informant des possibilités offertes par l’archéologie. L’histoire n’était pas si loin, elle ne fut pas écartée, bien au contraire.

Un programme fut établi, visant à développer le goût pour l’histoire et l’archéologie. Car l’idée force de la jeune association était de prouver que ces disciplines peuvent être appréhendées d’une manière passionnelle. Elle s’adressait alors à tous ceux qui n’étaient pas encore entrés dans le métier, ou qui en étaient sur le seuil, en attendant d’en goûter les charmes.
Le 26 novembre, sous la présidence de M. Andru, on comptait 120 adhérents à l’assemblée générale. Le président élu fut Arnaud de Maurepas, que nous perdions neuf ans plus tard.
Deux grands axes à la naissance du bureau ont été définis :
- d’abord, nourrir un bulletin mensuel, ouvert aux chercheurs comme aux élèves, Le Mois de l’histoire, en parallèle de la revue, toujours présente, elle, L’Émoi de l’Histoire, publiée annuellement.
- puis le second, s’intéresser aux différents contacts que l’association pourrait prendre avec d’autres organismes à vocation historique. A l’époque : l’association Mémoire des Lieux, le centre international d’Études Romanes, des chantiers de fouilles archéologiques, ou encore une librairie de la rue Saint-Sulpice achetant et distribuant sympathiquement L’Émoi ; plus récemment, le département d’histoire de Panthéon-Sorbonne et les autres participants à la Nuit des Idées ; et aujourd’hui, la fondation de l’Abbaye de la Lucerne d’Outremer, le château de Tournoël et d’autres.
Durant toute l’année scolaire, l’enjeu était de faire venir « chaque mois un grand nom de l’histoire » au sein d’un cycle de conférences. Ainsi Marcel Bordet, Jacques Julliard, David Ned Blackmer, Jacques le Goff, René Rémond, Mona Ozouf, André Corvisier, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacqueline de Romilly, Claude Gauvard, Marc Fumaroli, Yves-Marie Bercé, et tant d’autres.
Trois statuts avaient été définis, entre membres honoraires, membres bienfaiteurs et membres actifs.

Le petit mot laissé par Jerphagnon dans le livre d’or de l’association témoigne des nombreux historiens qui voyaient d’un oeil favorable de jeunes étudiants s’intéresser activement à leurs travaux : « On ne saurait rien refuser à une association aussi sympathique et je vous félicite de ce que vous faites pour les études historiques ».
S’ensuivirent de cordiales relations avec des revues comme Historia, Historama, L’Histoire, Historien et Géographe, ou même des institutions comme la direction des archives de France, la cinémathèque française, Cinécom…
Des projets extrêmement variés se retrouvent dans les archives de la vie de l’association : manifestations diverses, expositions, forum, soirées cinéma, face à face entre des historiens sur des sujets prêtant à discussion, constitution d’une documentation historique et archéologique, une excursion archéologique en Île-de-France pour l’été, et une petite note rêveuse de projet dans un des comptes-rendus d’assemblée générale : « mise en place d’antennes régionales et pourquoi pas internationales… »
On comprend que le lieu, ce lycée, ait exalté. Demandez que l’on vous présente succinctement ces murs, se dégage l’âme de ce bâtiment, dans lequel chaque élève comprend la profondeur en s’y baladant. Creusez ici, n’importe où, déplacez un meuble, un caisson d’archives, une boîte en carton, avancez-vous dans les salles de cette belle bibliothèque Sainte-Geneviève, perdez-vous dans une aile, poussez une porte des combles, descendez à la cave… vous tomberez sur quelque chose. Sous cette estrade, là, deux pierres tombales… quel élève d’Henri IV n’a pas rêvé sonder les greniers, voir Paris depuis la tour, entendre la rue depuis les souterrains qu’il suppose fantastique. Un cloître, une abbaye, qu’il a depuis quelques années la chance de voir se restaurer petit à petit, se reconstruire.
Ce terrain de vie que constitue le lycée Henri IV ne pouvait que stimuler cette association fidèle de Clio.